Glace "artisanale", café "tradition", yaourt "fermier"... Arnaque ou qualité? Trois termes décryptés

Lundi 24 mars, c'est la journée de la "glace artisanale". Une des principales idées préconçues est celle selon laquelle ce qui est "artisanal" est nécessairement fait maison. Dans l'esprit du consommateur, le glacier artisanal fabrique lui-même ses glaces avec des produits bruts, du sucre, des fruits, du lait etc.
Mais au fait, ça veut dire quoi, artisanale? L'emploi du terme est-il gage de qualité? Ou peut-il être utilisé librement par les commerçants à de pures fins marketing? Et qu'en est-il d'autres appellations régulièrement utilisées, qui sentent bon le terroir et le fait maison: traditionnel, rustique, fermier...?
L'artisan glacier n'a aucune obligation légale de fabriquer lui-même ses glaces, de même que l'artisan boulanger n'est pas tenu de faire ses viennoiseries et pâtisseries (seul le pain doit être fait sur place pour pouvoir être qualifié d'artisan boulanger) ou que le charcutier peut se contenter de revendre des rillettes ou du boudin achetés ailleurs.
La cuisine pour exception
En réalité, le terme "artisanal" qualifie la personne et non le produit: est artisanal ce qui est vendu par un artisan. Le titre d'artisan est protégé: pour l'obtenir, il faut un diplôme (CAP boulanger, par exemple) ou trois ans d'expérience.
Le code de l'artisanat indique également la nécessité d'être inscrit au Répertoire national des entreprises. Mais il n'impose rien sur le mode de fabrication des produits commercialisés par l'artisan: pas de cahier des charges, pas d'obligation de faire soi-même.
Bien sûr, de nombreux artisans vendent leurs propres réalisations. Certains peuvent toutefois être tentés de s'approvisionner auprès d'industriels pour tout ou partie de leur offre, pour des raisons de coûts, de praticité ou pour élargir leur gamme, particulièrement ceux qui proposent un grand nombre de produits transformés (sandwichs, plats traiteur, etc).
Il existe une exception pour l'artisan cuisinier. Le titre impose au restaurateur de faire ses plats maison. Mais en dehors de cette singularité, pour le consommateur, difficile voire impossible de faire la différence: rien n'impose aux artisans d'indiquer lorsqu'un produit n'est pas fait maison.
"Tradition": souvent du pur marketing
Un autre terme qui évoque un savoir-faire, une recette ancestrale, quelque chose fait à la main: "tradition", ou "traditionnel". Mais là encore, attention aux confusions. L'emploi du mot est encadré dans certains cas, purement marketing dans d'autres.
Un chocolat dit traditionnel est par exemple un chocolat pur beurre de cacao (sans ajout d'autre graisse végétale). Une échalote traditionnelle est une échalote cultivée et récoltée à la main, à la différence d'une échalote de semis. Une baguette de tradition doit respecter un cahier des charges strict en termes de composition. Le mot "tradition" accolé à ces trois produits a un sens précis.
En revanche, du café "tradition", du beurre "traditionnel", des saucisses de Toulouse "traditionnelles" ou encore des frites surgelées "tradition" ne renvoient à aucune signification officielle: ce sont des termes utilisés librement par les marques à de pures fins commerciales.
Même constat pour les mentions "à l'ancienne": des chips à l'ancienne sont des chips coupées plus finement, tout simplement. Leur recette n'a rien d'ancestral ni quoi que ce soit de particulier par rapport à d'autres. "Rustique" ou "grand-mère" sont également des appellations régulièrement utilisées par l'industrie agroalimentaire pour le marketing.
"Fermier": un terme encadré
Au contraire, le terme "fermier" ne peut pas être utilisé n'importe comment par l'industrie agroalimentaire. Il est encadré et ne désigne que les produits faits à la ferme, par l'agriculteur.
Chaque catégorie de produits concernés fait l'objet de décrets précisant les conditions: des œufs "fermiers" sont forcément pondus par des poules élevées sous le mode de production biologique ou en plein-air et produits dans une exploitation de moins de 6.000 poules.
Attention, donc, aux multiples appellations utilisées dans le domaine alimentaire pour améliorer l'image de produits parfois sans réels fondements en termes de qualité. La réglementation ne limite l'emploi que de certains termes, laissant libre cours à l'usage d'autres mentions qui peuvent prêter à confusion.
La Direction générale de la concurrence, la consommation et la répression des fraudes contrôle que les éléments marketing ne trompent pas les consommateurs. Mais dans les cas où la loi est peu contraignante, RMC Conso vous recommande de vous fier à des labels officiels et de qualité:
- Le fait maison et son logo: une des meilleures manières de savoir si les plats d'un restaurant, d'un charcutier-traiteur ou les viennoiseries et pâtisseries d'un boulanger sont maison.

- Les labels de qualité mis en place par les confédérations d'artisans: pour protéger leur réputation, la plupart écrivent elles-mêmes des chartes de qualité qui engagent les professionnels du secteur qui y adhèrent: Boulanger de France pour les boulangers, Qualichef pour les charcutiers, Glaces et sorbets de tradition française pour les glaciers.


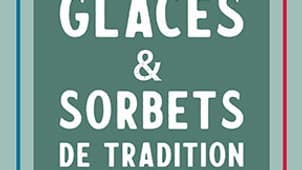
- Les labels publics officiels: label rouge, AOP, IGP ou encore "Agriculture biologique".
