Marchés publics: faut-il instaurer une préférence nationale? Ça fait débat sur RMC
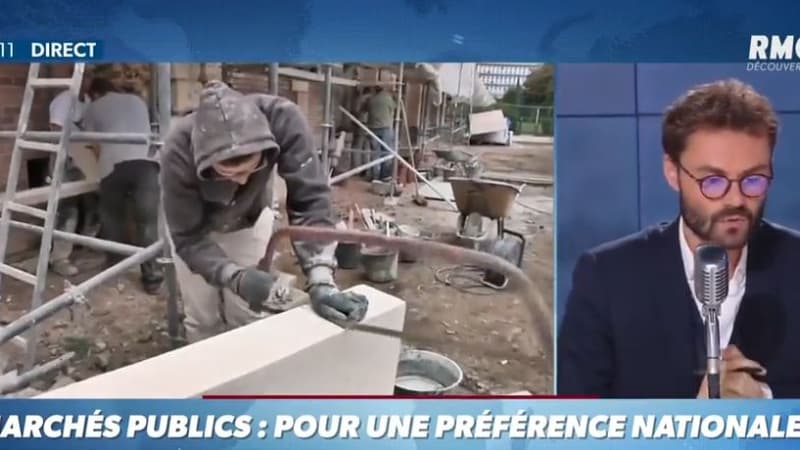
- - -
La pratique est déjà largement répandue en France, notamment en Outre-mer pour défendre l’emploi local en Nouvelle-Calédonie et à la Réunion, mais aussi à Paris. La ville a signé une charte pour encourager les commerces à embaucher des Parisiens précaires. En Corse, on favorise le BTP de l’île pour les gros chantiers de construction. Même chose en région Sud ou encore en Auvergne-Rhône-Alpes où 95% des contrats publics signés l’an dernier l’ont été avec des entreprises locales, notamment pour alimenter les cantines.
Il y a tout à y gagner selon Jacques Blanchet, entrepreneur BTP dans la Loire et conseiller de Laurent Wauquiez: "Ce qui est intéressant c'est que l'on fait travailler les entreprises locales, donc les salariés locaux qui habitent et paient des impôts localement et régionalement. L'intérêt c'est aussi que les habitants de la région voient que les travaux sont réalisés par des locaux de façon à ce que l'emploi soit préservé dans notre région sur nos marchés".
A priori, c’est interdit en Europe. La loi garantit le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination des candidats à un appel d’offres. Mais il est possible d’insérer des clauses dans le contrat pour contourner ce principe. Nécessité d’assurer une rapidité d’intervention, d’assurer la proximité, l’accessibilité, la connaissance du tissu local, des exigences en lien avec l’environnement et le développement durable.
"S'il y a moins de concurrence, les entreprises locales vont s'affadir"
C’est comme ça qu’en France, mais aussi en Grèce, en Espagne, en Italie, la préférence nationale ou régionale gagne du terrain. En Allemagne aussi, avec 35% de contrats, même si paradoxalement, cette même Allemagne est le pays qui défend le plus le principe de libre concurrence au niveau européen. Et elle a bien raison, selon Jean-Philippe Delsol, président de l’Institut de recherches économiques et fiscales: "S'il y a moins de concurrence, les entreprises locales vont avoir tendance à s'affadir, à être moins innovantes, à moins rechercher l'efficacité, la productivité, les meilleures solutions. Ça risque de coûter plus cher pour le consommateur ou pour le contribuable. Ce serait une erreur".
Le texte de référence en à la matière, c’est le Buy American Act, promulgué en 1933 aux Etats-Unis et qui oblige encore les agences fédérales à s’approvisionner d’abord avec des produits made in USA. Lors de sa campagne, Emmanuel Macron reprenait le modèle et disait vouloir instaurer un Buy European Act pour limiter le recours aux travailleurs détachés hors Union européenne.
