Faut-il une dégressivité des allocations chômage? Ca fait débat sur RMC
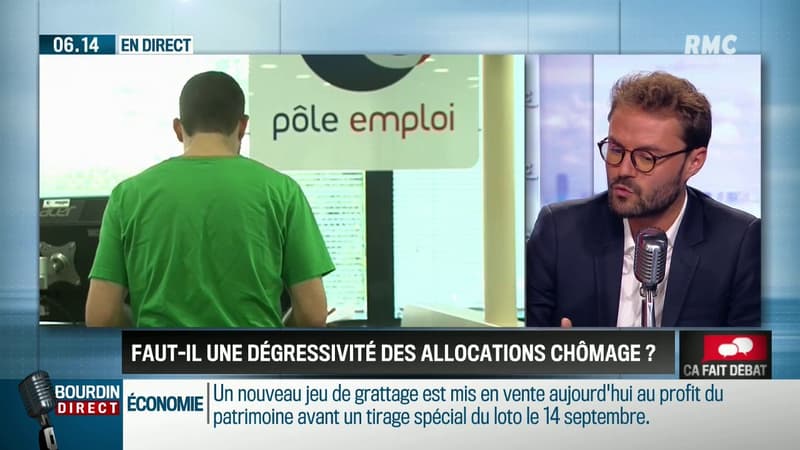
Faut-il une dégressivité des allocations chômage? Ca fait débat sur RMC - RMC
Faut-il mettre en place la dégressivité des allocations chômage? Le gouvernement n'a, en tout cas, "aucun tabou", selon la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, reprenant les éléments de langage d'Edouard Philippe.
Le député LREM Aurélien Taché avait évoqué quelques jours auparavant la possibilité d'une "dégressivité" des allocations pour les cadres supérieurs, estimant que la "justice sociale" ne consistait pas à "couvrir pendant deux ans des gens qui ont de très hauts revenus et pourraient trouver un emploi". Une proposition a provoqué la colère de la CFE-CGC, le syndicat des cadres.
La ministre du Travail a rappelé que la réforme de l'assurance chômage avait deux "buts essentiels": "lutter contre la précarité excessive" et "inciter au retour à l'emploi". Il y a des règles du régime d'assurance chômage qui "quelquefois se transforment en un piège", a-t-elle dit, en évoquant les règles liées à la permittence (travail par intermittence, alternant avec des périodes indemnisées).
Comment font nos voisins européens?
Alors que les négociations avec les partenaires sociaux reprennent, certains soulignent que la France est l’un des "rares pays d’Europe à indemniser sans dégressivité". Et ça n’a rien d’étonnant. La dégressivité est une mesure recommandée par Bruxelles. Un rapport de la Cour des comptes de 2015 rappelle d’ailleurs que le conseil européen a plusieurs fois citer la dégressivité comme une piste de réforme demandée à la France.
A l’heure actuelle, un chômeur Français est indemnisé à 57% de son ancien salaire, du premier au dernier jour de ses droits. Pendant 3 ans pour les seniors, 2 ans pour les autres. La dégressivité, comme son nom l’indique, impliquerait que ce taux diminue au fil du temps. C’était d’ailleurs le cas en France entre 1986 et 2001, jusqu’à ce que le gouvernement Jospin y mette fin.
Aujourd’hui, 6 grands pays européens pratiquent la dégressivité: Espagne, Portugal, Italie, Belgique, Pays-Bas et Suède. Mais elle n’est pas appliquée de la même façon partout. En Espagne, on passe de 70% à 50% du salaire au bout de 6 mois. En Italie, c’est 75%, puis 60% au bout de six mois et 45% au bout d’un an. En Suède, on passe de 80% à 70% au bout de 200 jours.
"Certains ne vont pas reprendre un emploi car ils vont perdre de l'argent"
Une mesure qui inciterait à retrouver du travail plus rapidement pour Jean-Eudes du Mesnil, secrétaire général de la CPME:
"Il y a des gens qui font des arbitrages et qui considèrent que leurs intérêts sur le plan financier, c'est de ne pas reprendre un emploi car ils vont perdre de l'argent. Ce n'est pas admissible. Il faut lutter contre ça. Il s'agit évidemment de ne pas dire que les demandeurs d'emplois sont des tire-au-flanc. Mais la dégressivité est l'un des outils auxquels il faut réfléchir aujourd'hui".
Mais cette dégressivité permet-elle vraiment de réduire le nombre de demandeurs d’emploi? Pas vraiment. Si l’on compare les courbes du chômage sur 10 ans, difficile de dégager une tendance. Les pays qui pratiquent la dégressivité n’ont pas un taux de chômage inférieur aux autres.
On se trompe de débat, "L'idée sous-jacente serait que les salariés profiteraient du système et qu'il faudrait réduire les allocations pour les pousser à travailler comme s'ils étaient cramponnés au chômage telles des moules sur le rocher. C'est toujours cette petite musique qui consiste à faire passer les salariés pour des fainéants et des profiteurs. Quand Muriel Pénicaud dit qu'il n'y a 'aucun tabou', il faut préciser aucun tabou pour la régression sociale dans ce pays pour les salariés. D'idées taboues, le gouvernement en a plein dès qu'il s'agit des chefs d'entreprises".
Le véritable avantage de la dégressivité, c’est son effet sur les finances de l’assurance chômage. Elle a ainsi permis de réduire le déficit dans tous les pays qui l’ont mise en place. En France, la dette de l’Unedic était de 3,6 milliards en 2017. Mais ça devrait aller mieux: 2 milliards prévus pour 2018 ; et seulement 600 millions en 2019, grâce au retour de la croissance et de l’inflation.
